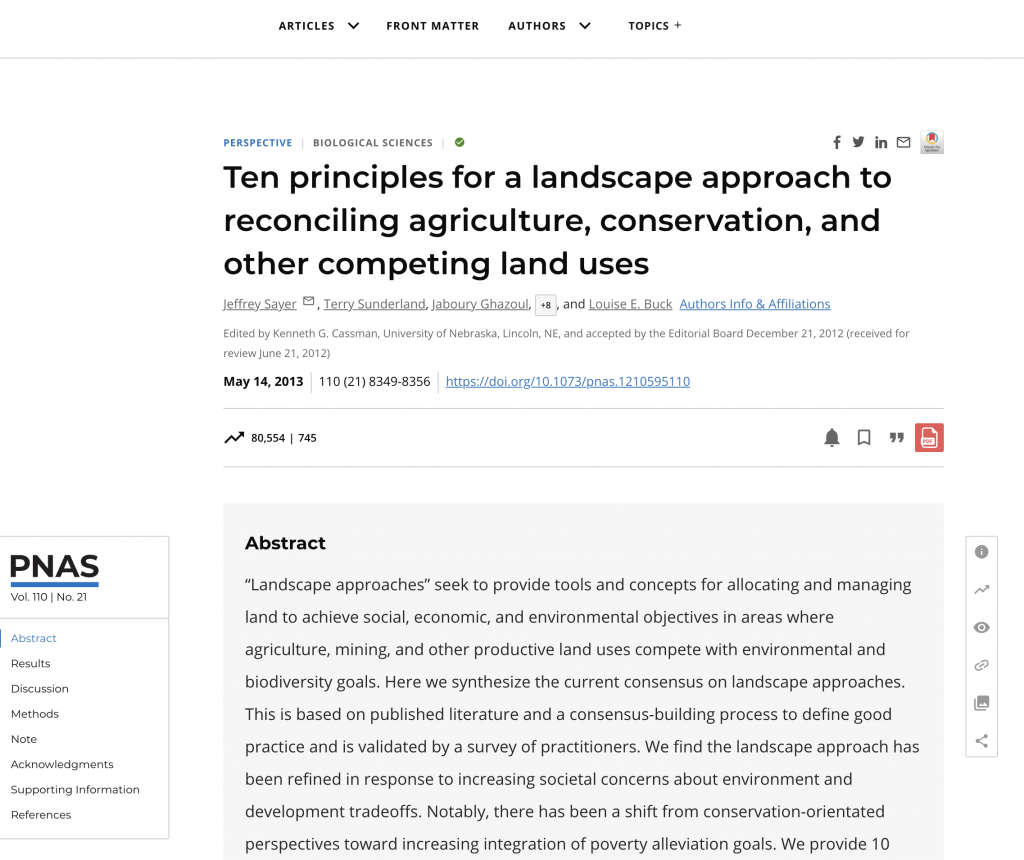Au cours des derniers mois, la composante centrale du LFF en Amérique latine a collaboré avec les initiatives La gestion intégrée des paysages (la GIP) financées par l’UE afin de mieux comprendre comment les différentes dimensions de la GIP fonctionnent dans la pratique, en particulier l’apprentissage itératif et adaptatif.
L’apprentissage itératif et adaptatif est une caractéristique clé des initiatives efficaces la GIP. En effet, les paysages sont des systèmes socio-écologiques très complexes et dynamiques, avec des éléments multiples et dynamiques en interaction et un degré élevé d’incertitude quant à leur évolution.
« Un système socio-écologique est un système intégré de personnes et de nature, où les composantes écologiques et sociales sont interdépendantes et évoluent par rétroaction.
– Elinor Ostrom, 2009
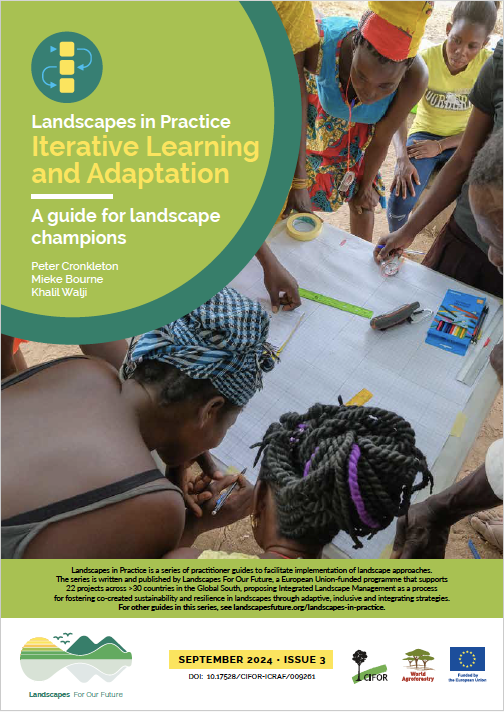
Comme nous l’avons décrit dans notre ligne directrice « Paysages en pratique », l’apprentissage itératif est un processus continu et cyclique d’apprentissage par l’action, la réflexion et l’ajustement. Il implique de tester des idées ou des stratégies, d’observer les résultats, de recueillir des informations en retour, puis d’affiner les approches en fonction de ce qui a été appris. Plutôt que de suivre un plan fixe, l’apprentissage itératif permet de s’adapter au fil du temps, en particulier dans des environnements complexes ou dynamiques. Sans processus d’apprentissage itératif, les initiatives peuvent tomber dans le piège d’une planification statique et de solutions technocratiques descendantes. Ce processus d’identification des meilleures pratiques et d’amélioration au fil du temps est souvent décrit comme une approche « d’apprentissage par la pratique ».
Afin d’encourager les promoteurs du site la GIP à réfléchir au rôle de l’apprentissage itératif et adaptatif dans leur travail, l’équipe LFF a facilité des activités de réflexion avec ces praticiens du site la GIP, en les aidant à tirer les leçons de leurs propres expériences.
La facilitation a inclus des échanges de groupes, des ateliers, des discussions bilatérales et des échanges entre pairs à travers les régions.
En novembre 2024, la Composante centrale a organisé un webinaire sur l’apprentissage itératifqui a réuni des collègues de plusieurs projets la GIP, dont Paisajes Andinos (Équateur), Mi Biósfera (Honduras), le projet OECS-la GIP (Organisation des États des Caraïbes orientales) et Paisajes Sostenibles (Colombie).
Ce rassemblement s’est concentré sur le partage des connaissances et le dialogue entre les praticiens de la GIP dans la région afin de mettre en évidence des solutions et des approches pratiques pour l’apprentissage itératif et d’encourager la réflexion sur la gouvernance, l’institutionnalisation et l’engagement des parties prenantes pour la gestion adaptative.
Les partenaires du LFF ont mis l’accent sur le rôle essentiel des partenariats intersectoriels dans l’obtention de résultats durables en matière de paysage. Les intervenants ont souligné qu’il n’est pas toujours facile de créer et de maintenir ces partenariats, en particulier entre les gouvernements, les communautés et les ONG, surtout dans des contextes politiques et financiers changeants. Pourtant, c’est précisément cet esprit de collaboration qui permet un impact à long terme, et les approches paysagères sont, par nature, des investissements à long terme.
Khalil Walji, représentant de la composante centrale de la LFF, a fait remarquer : « Grâce à nos missions conjointes de réflexion et d’apprentissage, nous avons pu constater de première main que l’apprentissage collaboratif peut conduire à des améliorations significatives dans les efforts de restauration des terres ».
Les participants ont échangé de nouvelles idées sur des stratégies innovantes visant à renforcer ces alliances, telles que des modèles de gouvernance participative et des initiatives de renforcement des capacités, soulignant ainsi le rôle essentiel de la coopération dans l’obtention de résultats durables en matière de gestion des paysages.
Le webinaire a mis en lumière la stratégie du LFF qui consiste à encourager la collaboration entre les projets afin d’améliorer les pratiques et les résultats en apprenant les uns des autres.
Le fil conducteur de ces expériences est la valeur de l’intégration des connaissances locales dans les stratégies de gestion des paysages et la possibilité pour les gestionnaires de ressources locaux de s’exprimer et de s’approprier le processus. Nous pensons que l’intégration des connaissances locales dans nos pratiques est essentielle pour assurer la durabilité de la gestion des paysages.
Leçons tirées du terrain : Comment l’adaptation s’est-elle manifestée dans les paysages LFF ?
Équateur – Paisajes Andinos
Lors de notre visite en Équateur en mars 2025, l’équipe de Paisajes Andinos a raconté l’approche qu’elle avait utilisée pour soutenir la conservation communautaire d’un paysage de páramo menacé dans la paroisse de Simiátug. Plutôt que d’imposer un modèle de conservation prédéfini, le projet a aidé les acteurs locaux à explorer les mécanismes de gouvernance par le biais de visites d’échange et de dialogues. Ils ont lancé un processus dans le cadre duquel les communautés rendent visite à d’autres pour tirer parti de leurs expériences, ce qui a permis aux communautés cibles entourant le paramo de tirer parti de leurs expériences. Cela a permis aux communautés entourant les páramos ciblés d’identifier des mécanismes de gouvernance potentiels qui préservent les ressources et garantissent les droits. Le projet a également consacré du temps à l’instauration d’un climat de confiance entre les communautés et le ministère équatorien de l’environnement. En conséquence, les communautés ont décidé qu’un mécanisme connu sous le nom de zone de protection hydrologique était le mieux adapté à leurs besoins et ont rejoint les gouvernements locaux et nationaux, les ONG et la FAO dans un effort de collaboration pour délimiter et développer cette zone.
Colombie – Paisajes Sostenibles



Lors d’une mission d’apprentissage à Santa Marta, en Colombie, en avril 2025, le personnel de Paisajes Sostenibles INVEMAR, partenaire de Paisajes Sostenibles, a raconté son expérience de travail avec les pêcheurs de la Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM). En réponse au déclin observé du stock de crabes bleus dû à la surpêche, les techniciens ont introduit des pièges innovants comprenant des ouvertures permettant aux crabes juvéniles de s’échapper. Lors des visites de contrôle, les techniciens ont remarqué que de nombreux pêcheurs avaient bloqué les ouvertures et continuaient à récolter les crabes, quel que soit leur stade de croissance. Les techniciens d’INVEMAR ont donc modifié leur stratégie et mis en place une expérience participative avec les pêcheurs pour contrôler les récoltes à l’aide de ces pièges innovants. Grâce à ce processus, les pêcheurs ont compris qu’en se concentrant uniquement sur les crabes de grande taille, ils ne réduiraient pas leur récolte, mais qu’ils s’assureraient d’avoir plus de crabes à l’avenir. L’acceptation des pièges modifiés s’est accrue car les pêcheurs ont non seulement vu comment ils fonctionnaient, mais ils se sont également sentis concernés, puisqu’ils avaient validé cette solution.
Brésil-Paraguay – Cerrado Resiliente
Lors de notre visite au Paraguay en mai 2025, les techniciens du projet CERES (Cerrado Resiliente) ont utilisé une approche de planification flexible qui leur a permis de faciliter les cycles d’apprentissage itératifs avec les parties prenantes dans la zone d’Agua Dulce autour du Monumento Natural Cerro Chovoreca. Les propositions initiales du projet (par exemple, des corridors biologiques formels) s’étaient avérées non viables en raison d’intérêts conflictuels entre les parties prenantes. Plutôt que d’insister sur ces idées originales, le projet s’est concentré sur la socialisation de l’idée de connectivité à l’aide de cartes et de dialogues, gagnant ainsi en légitimité sans résistance. Grâce à ce processus, il a été possible de rassembler les intérêts locaux autour d’une stratégie visant à délimiter la zone de conservation du Cerro Chovoreca, ce qui permettrait aux propriétaires terriens locaux de clarifier également les limites de leurs propriétés. Ce recadrage a permis de déplacer l’attention d’une intervention potentiellement conflictuelle vers une vision collaborative de la gouvernance du paysage. La collaboration entre les agences gouvernementales, les communautés locales, le secteur privé et les ONG a abouti à l’institutionnalisation de la gouvernance des paysages dans la zone frontalière. En bref, l’apprentissage adaptatif a permis de progresser dans un contexte politiquement sensible, écologiquement important et opérationnellement difficile.
L’apprentissage itératif apparaît comme un puissant moteur d’action dans les paysages du LFF, car il permet aux projets de rester réactifs, adaptables et ancrés dans les réalités locales. Plutôt que de s’appuyer sur des plans rigides, les équipes de projet adoptent des approches flexibles et axées sur le retour d’information qui leur permettent d’apprendre aux côtés des communautés, d’ajuster les stratégies sur la base d’informations en temps réel et de cocréer des solutions à la fois efficaces et légitimes sur le plan local. Qu’il s’agisse d’échanges entre pairs en Équateur, d’expériences participatives en Colombie ou de planification adaptative au Paraguay, ce processus d’apprentissage continu aide à surmonter les défis politiques, écologiques et sociaux, traduisant la réflexion en progrès tangibles sur le terrain.